A son habitude, le cinéma américain n’a pas tardé. Trois ans à peine après la chute de Saïgon sortait sur les écrans Voyage au bout de l’enfer, saga de trois heures sur le traumatisme encore brûlant de la guerre du Vietnam. D’autres films s’empareront du sujet (Retour d’Hal Ashby en 1978, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en 1979, Cutter’s Wayd’Ivan Passer en 1981…), mais le deuxième long-métrage de Michael Cimino marqua autant le public, la critique que l’académie des Oscars qui lui décerna cinq statuettes (dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur).
Il ne faut pas se fier au titre français (emphatique et s’inspirant du Voyage au bout de la nuit de Céline), tellement éloigné de l’original (The Deer Hunter, « le chasseur de cerf »), et les amateurs de purs films de guerre seront vraisemblablement déçus par la variété des climats, la longueur du récit, la complexité des personnages et des situations.

Le film de Cimino se compose de trois parties. La première plonge le spectateur en 1968 dans la communauté ouvrière d’une petite ville de Pennsylvanie au sein de laquelle trois amis sidérurgistes – Mike (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) et Steven (John Savage) – sont appelés à servir au Vietnam. Scènes de la vie quotidienne, mariage, banquet, chasse au cerf cernent les mœurs de personnages pour la plupart descendants d’émigrés russes.
Sans transition, la deuxième partie bascule brutalement dans « l’enfer » promis de la guerre du Vietnam. On retrouve les trois personnages prisonniers de combattants du Vietcong qui les obligent à jouer à la roulette russe. Ils parviennent cependant à s’échapper. Steven, qui a perdu l’usage de ses jambes, et Mike rentrent aux Etats-Unis, mais Nick déserte et choisit de rester à Saïgon. Enfin, la troisième partie retrace à la fois le retour des deux survivants parmi les leurs et la tentative de Mike de ramener son ami Nick de Saïgon sur le point de tomber.
Et Christopher Walken creva l’écran
Voyage au bout de l’enfer marqua les esprits par les scènes devenues cultes de roulette russe tout autant que par la séquence ultime où le God Bless America entonné par les personnages est à la fois le signe d’un deuil et celui d’une espérance. Certains virent là une œuvre patriotique, voire raciste à l’égard des Vietnamiens. Le même contresens aura lieu un peu plus tard avec le Rambo de Ted Kotcheff ou la chanson Born in the USA de Bruce Springsteen.
Sans avoir besoin de signer une banale homélie pacifiste, Cimino montre l’horreur de la guerre. Il n’y pas de héros parmi les soldats américains qu’il filme, juste des hommes plus ou moins brisés, à jamais blessés pour ceux qui ont survécu.
Evidemment, on n’aurait rien dit de ce chef-d’œuvre sans évoquer son éblouissant casting : Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale, John Savage et l’incroyable Christopher Walken.
On l’avait furtivement aperçu dans Le Gang Anderson de Sidney Lumet ou dans Annie Hall de Woody Allen.
Là, son incroyable présence et sa beauté singulière crèvent l’écran. L’acteur se singularisera par d’autres compositions inoubliables dans Dead Zone de David Cronenberg, Comme un chien enragé de James Foley, The King of New York d’Abel Ferrara, Etrange séduction de Paul Schrader tandis que Tim Burton, Steven Spielberg ou Clint Eastwood lui offriront aussi des rôles marquants. Mais c’est devant la caméra de Michael Cimino que l’on assista à la naissance d’un immense comédien. Les deux hommes se retrouveront pour le troisième film du réalisateur, La Porte du paradis, dont l’échec cinglant marqua la fin du « Nouvel Hollywood ».
> LES FILMS QU’IL FAUT AVOIR VUS
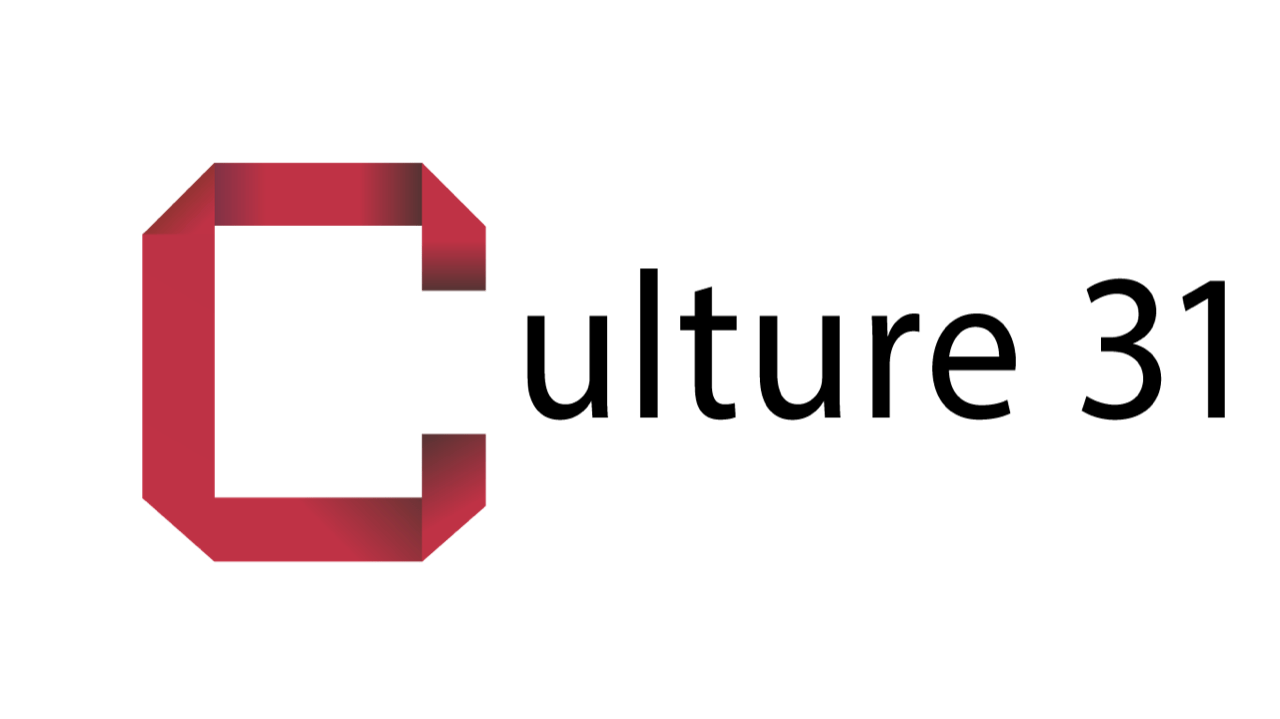







![【 Rencontre • #Culture 】
Aujourd’hui, dans « les acteurs de la culture », nous vous présentons l’artiste Dominique Kermène.
.
Formée aux Beaux-Arts, cette peintre et graveuse francilienne délivre jusqu’au 31 mai 2025 un art brut et libre, inspiré par la nature et l’humain, à la Galerie 21. En somme, il s’agit d’une quête trouvée de liberté intérieure, qu’elle dévoile ici comme une visite.
.
« [Le] travail d’artisan d’art me plaît […] Cette exposition, c’est une vie d’artiste et ce n’est pas fini » .
.
🔗 Retrouvez son interview sur le site de Culture 31 (lien dans notre bio)
.
.
.
#acteurdelaculture #musiqueclassique #galerie21 #dominiquekerme #culturetoulouse #toulouse #culture31 @galerie21toulouse @dominiquekermene](https://scontent-lhr6-2.cdninstagram.com/v/t51.75761-15/489811343_18280379245251283_198464044381026463_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=HUhKQrGb930Q7kNvwFFMW7v&_nc_oc=Adn9_H9p9sJJ-fTyKHxsiC_hZDg-wAqZnynTYSNDGOTG4QevUBMfeKJY6ke4Mm6bEq0&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr6-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=1Y4nZ55_Xlwr_CP1bMwZ0g&oh=00_AfFd7Q2JxmYtbjfwnk4XD93i4ZIbrXd0qKFEabHirf0Qtg&oe=68017845)












