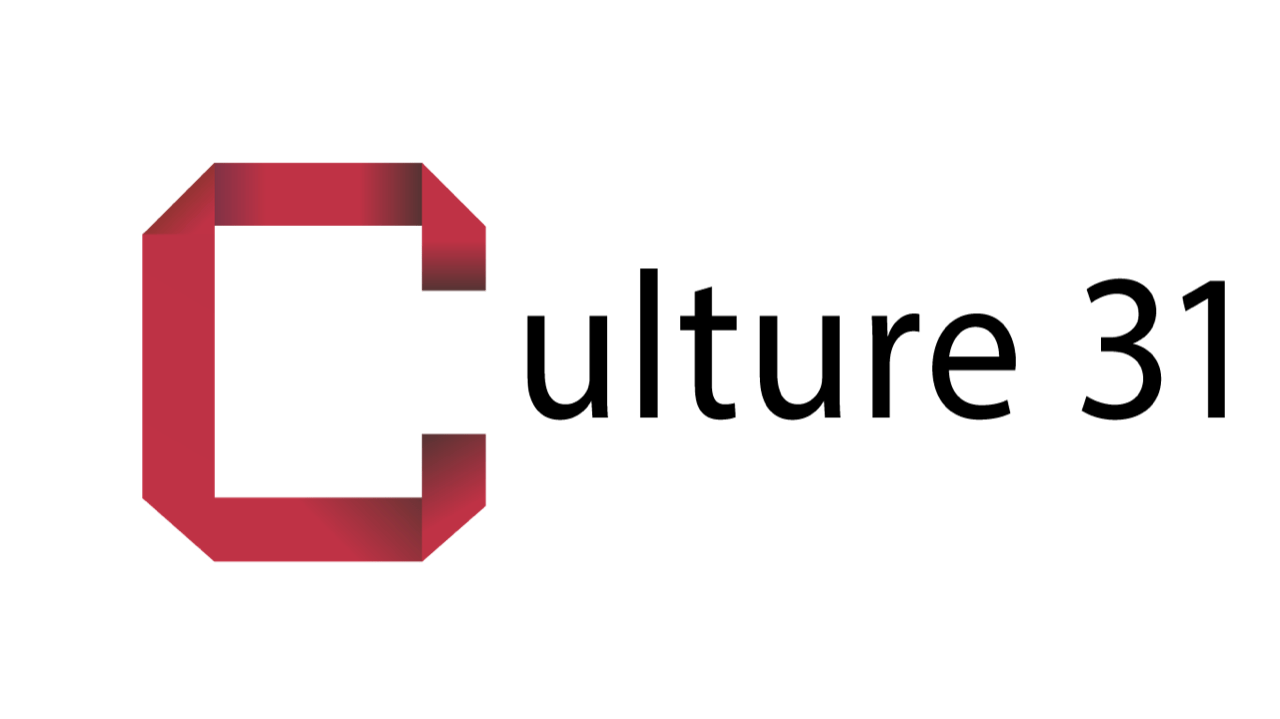Quand tant d’écrivains stakhanovistes nous inondent de leurs dispensables écrivains, certains se contentent d’être les auteurs d’un unique roman qui suffit à nous accompagner des années durant. On songe ainsi à Guillaume Clémentine et à son merveilleux Petit Malheureux ou à Lauren Rochut et à son Peine perdue paru en 2006. C’est un jour de mai 2002 à Paris que le narrateur écrit une longue lettre à sa mère qui fut tour à tour « maoïste, communiste révolutionnaire, MLF puis socialiste » avant de retrouver sa bourgeoisie originelle entre droite gestionnaire et social-démocratie. Du père, il ne lui reste que quelques souvenirs et une édition écornée de l’Histoire du cinéma de Georges Sadoul. À travers cette lettre en forme de déclaration de guerre, on va découvrir la destinée d’un jeune homme né dans une époque de basses eaux. À l’heure de sa majorité, Julien a choisi la Sorbonne plutôt que Saint-Cyr. Bien mal lui en prit : « Quatre ans à fréquenter des imbéciles, aussi soixante-huitards que leurs parents, partageant le même amour de la crasse, des utopies sociales et des penseurs à gages, fiers de leurs parents, « citoyens » à s’en vomir dessus, frétillant à la première évocation des droits de l’homme ». À l’écart de ses contemporains, il se consolera en lisant Rabelais, La Bruyère, Stendhal, Barbey, Bloy, Apollinaire ou Bernanos – puissantes rations de survie pour les âmes en peine.

Après s’être engagé pour cinq ans dans l’armée, il part dans la Bosnie en guerre. Là-bas, il découvre l’impuissance et le mensonge comme les ingrédients d’une Histoire dont les multinationales et les officines de désinformation ont pris les commandes avant de céder à une rage vengeresse lors d’un accrochage virant au massacre. L’armée couvre le « dérapage ». Retour en France dans l’opprobre et la honte. Comment fuir ce marasme ? Même le couple qu’il forme avec Alice s’effondrera.
Une langue maquisarde
Portrait d’une famille et d’une génération, ce roman d’initiation et d’apprentissage dépasse les clichés pour peindre avec subtilité une sorte d’orphelin, d’enfant humilié qui répond par la rage aux battements d’un cœur trop sensible. « Tout premier roman tient pour une part du règlement de compte » disait Mauriac. On solde, on liquide, on quitte des êtres ou des territoires condamnés. Laurent Rochut se livre à l’exercice en en évitant les pièges : aigreur, chahut, esbroufe… De même, la dimension politique du roman ne vient pas polluer l’expression des sentiments, de l’intimité et le délicat éventail de souvenirs que certaines pages déploient joliment. Julien a le bon goût et la sagesse d’abandonner les idées pour des ambitions plus élevées : « J’ai déserté les guerres des hommes. À quoi bon défendre un pays, les pauvres ou l’argent. L’histoire du monde est en boucle. C’est une loi des grands nombres, on ne peut que s’y perdre. Et puis le temps n’était ni aux révolutions ni aux épopées. J’étais fait pour les grandes ivresses, pas pour les villégiatures. J’ai écouté mon cher Musset. J’ai remonté le courant, le tumulte des passions collectives. J’ai écrit pour l’Homme, pas pour les hommes. Nous n’étions plus si nombreux à relever ce défi. » Peine perdue s’achève avec une seconde lettre dont on ne dévoilera pas le destinataire. Dernières notes poignantes d’un roman, à la fois lyrique et sec, révélant une voix : « Nous n’avons plus de pères à honorer. Juste une langue à hurler jusqu’à son extinction. Nous sommes la diaspora à venir, nous, écrivains de langue française. Nous sommes d’après la race, le terroir et le drapeau. Nous partons en exil dans les faubourgs du monde avec un verbe au cœur, un antique murmure, une langue maquisarde qui ne cesse de dire non. »