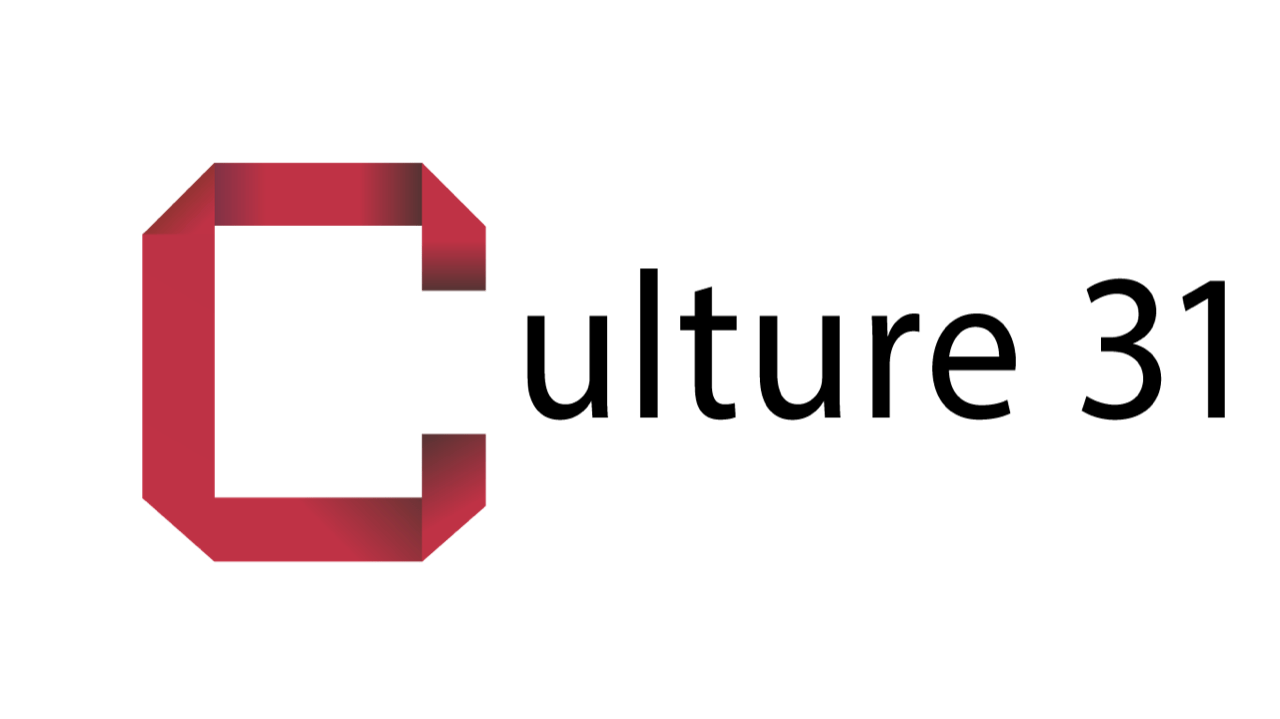Il faudra bien sept représentations pour satisfaire le public friand de ce type de ballet et ce, du 18 au 25 avril. La direction musicale est placée sous l’autorité du chef d’orchestre, chef de chœur, organiste et claveciniste Nicolas André et dans la fosse, ce sont des musiciens de l’Orchestre National du Capitole. Sur le plateau, le corps de Ballet de l’Opéra national du Capitole. Son dernier spectacle à la Halle, Chansons dansées fut une réussite, et l’on me dit que leur prestation au Théâtre du Liceu de Barcelone dans Semiramide et Don Juan fut de même ! La Directrice de la danse Beate Vollack a le vent en poupe, force 10 !

Cette production de Coppélia ou La Fille aux yeux d’émail est une création, l’œuvre de Jean-Guillaume Bart. Étoile de l’Opéra national de Paris en 2000 à 27 ans, il dansera tous les rôles du répertoire classique et néoclassique. Devenu maintenant chorégraphe, passionné par le style chorégraphique et la musique du XIXè. Ayant subi des problèmes de santé, trop tôt, il est dans sa nouvelle fonction d’une attention furieuse pour tous les danseurs et danseuses impliqués dans ses chorégraphies afin de les protéger un maximum.
La musique est bien sûr toujours de Léo Delibes. Antoine Fontaine est en charge des décors, le couturier Christian Lacroix des costumes et François Menou pour les lumières.

Coppélia constitue le dernier grand ballet romantique, en trois actes, créé le 25 mai 1870 sur une chorégraphie d’Arthur Saint-Léon qui fit appel pour la musique à Léo Delibes auquel ce ballet doit tout. Le compositeur est alors, avant tout devenu Chef de chœur à l’Opéra, dit l’Opéra Le Peletier et connaîtra l’Opéra Garnier inauguré enfin en janvier 1875. Quand il s’attaque à Coppélia sur demande, Léo Delibes a déjà une sérieuse expérience de la musique de ballet. Une musique qui sera ici qualifiée d’élégante et humoristique, aux rythmes variés et aux couleurs instrumentales contrastées. Véritable accomplissement du ballet-pantomime, Coppélia constitue l’un des ballets les plus représentatifs de l’École française basée sur le style élégant et raffiné enseigné alors au Ballet de l’Opéra de Paris. À la création, la ballerine-star est Giuseppina Bozzachi, jeune femme de dix-sept ans !! qui danse le rôle de Swanilda et son futur époux Franz dansé par Eugénie Fiocre, donc un rôle de travesti ! Nous sommes en 1870 et la période est favorable, très favorable aux danseuses ! et non aux danseurs dont la présence sur scène est fortement négligée, et même souhaitée le moins possible ! Preuve s’il en est avec ce rôle distribué à une danseuse.

Inspiré du conte Le Marchand de sable de Ernst Théodor Amadeus dit E. T. A. Hoffmann, poète romantique allemand et musicien, né en 1776, le livret met en scène Swanilda, son fiancé Franz et le vieux Coppélius, horloger et fabricant de poupées automates dont l’ambition est d’en créer une douée d’une âme. Franz va s’éprendre de la dernière création du vieillard entr’aperçue par la fenêtre : Coppélia, qu’il croît vivante. Swanilda, fort jalouse, finit par s’introduire dans son atelier. Franz va y pénétrer à son tour, surpris avec son échelle par Coppélius qui tente à l’aide d’un breuvage de sa composition de l’endormir pour lui ravir son âme. Et c’est alors que Coppélia petit à petit s’anime, et pour cause : Swanilda a pris la place de la poupée. Elle brise les automates et s’enfuit avec son fiancé qu’elle épousera finalement, après lui avoir pardonné, à la fête du village dite Fête de la cloche, n° 20 et dernier dans l’acte III – divertissement comportant pas moins de 8 numéros propres, de la Valse des heures au Galop final en passant par L’hymen (Noce villageoise).
Par sa prodigieuse abondance de danses de caractère (valses, mazurkas, ballades, czardas, boléros, gigue) Coppélia répond parfaitement au goût des balletomanes aux grosses jumelles de la fin du second Empire, des abonnés épris de divertissement plutôt que d’une action dramatique véritable. Soutenue par une partition de qualité, l’œuvre fera rapidement le tour des lieux prestigieux consacrant leur scène aux ballets (Bolchoï, Berlin, Gand, Metropolitan Opera House, Liceo…) Tchaïkovski sera l’un des plus fervents admirateurs des ballets créés sur une musique de Léo Delibes. Son premier ballet commandé dont il écrit la moitié de la partition, l’autre étant confié au célèbre Ludwig Minkus, fut La Source, un grand succès à sa création en 1866. Un opéra que Jean-Guillaume Bart reprit à l’Opéra de Paris en 2011 avec une chorégraphie tout à fait personnelle. En 1876, ce fut le troisième ballet : Sylvia, ou la Nymphe de Diane.

Effectif dans la fosse :
bois : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons
cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets à pistons, 3 trombones, 1 tuba
percussions : timbales, cymbales, grosse caisse, caisse claire, triangle, glockenspiel
cordes pincées : 1 harpe
cordes frottées : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses.
Alors, êtes-vous, Carlo Blasis, célèbre pédagogue en son temps début XIXè ? ou, partagez-vous les théories sur le ballet romantique de Théophile Gautier ? Ce dernier, partisan de l’art pour l’art, il l’est aussi de la danse pour la danse : « Si le pied est petit, bien cambré, et retombe sur la pointe comme une flèche, si la jambe, éblouissante et pure, s’agite voluptueusement dans le brouillard des mousselines, si le sourire éclate, pareil à une rose pleine de perles, nous nous inquiétons fort peu du reste. Le sujet peut n’avoir ni queue ni tête, ni milieu, cela nous est bien égal. Le vrai, l’unique, l’éternel sujet d’un ballet, c’est la danse. » C’est dit.