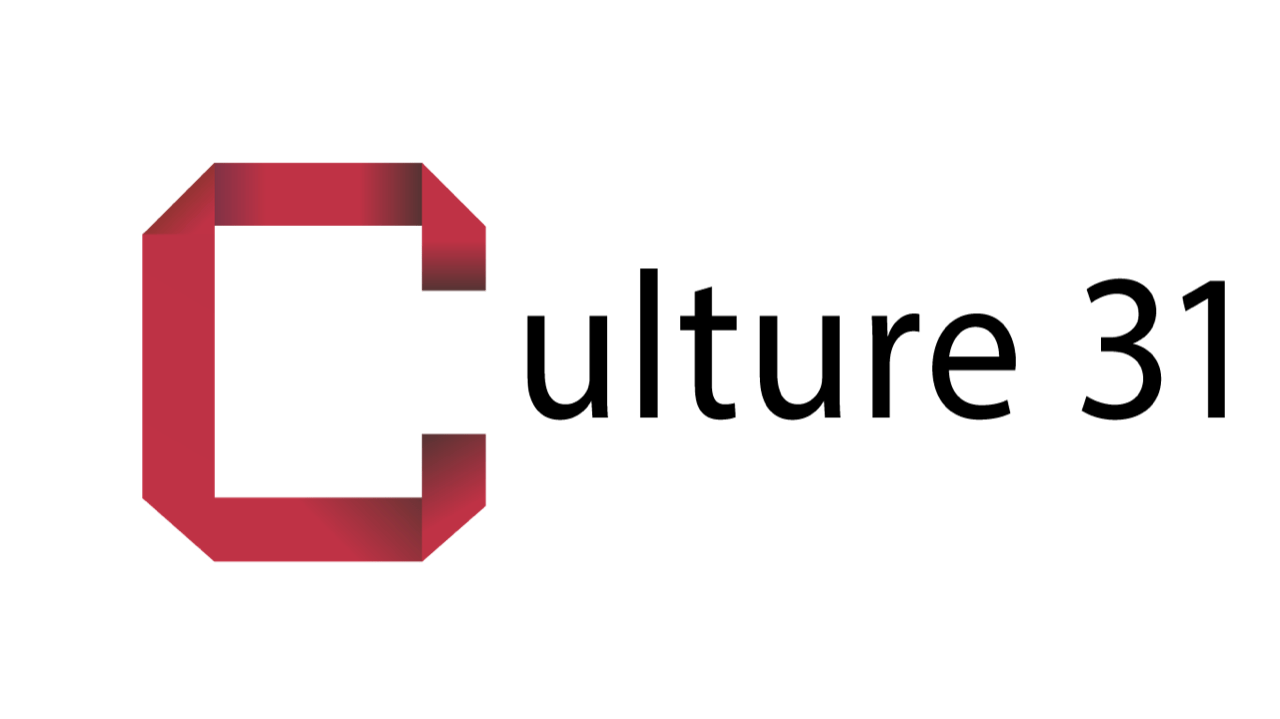Dans la lignée de ses récits Nous aurons toujours Paris ou En descendant les fleuves, «Carnets de l’Extrême-Orient russe» coécrit avec Christian Garcin, l’auteur de Nagasaki, grand prix du roman de l’Académie française en 2010, signe avec Somnambule dans Istanbul une évocation de ses pérégrinations à travers le monde, «une ébauche de cartographie de l’imaginaire» tenant autant de l’autoportrait fragmenté que du vagabondage littéraire.

«On n’habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c’est cela et rien d’autre», rappelle Eric Faye en citant Cioran : «Oui, avant tout une langue, à quoi j’ajouterais une époque, celle où l’on a grandi, qu’on ne quitte jamais vraiment, quand bien même on voudrait être de plain-pied avec son temps. Bien plus que d’un pays précis, je suis du XXème siècle.
Les briques qui me constituent ont été cuites à cette période et à nulle autre, quoi que je fasse pour prendre racine dans le nouveau millénaire.»
Rêveur au long cours
L’imaginaire et les penchants d’Eric Faye furent d’abord façonnés par les images des manuels d’Histoire, le Larousse universel et ses milliers d’illustrations, les noms baroques des rois fainéants, le goût des langues étrangères que le jeune garçon entretient alors avec des «correspondants» avant la rencontre et l’histoire d’amour avec le français, «cette grande et riche demeure ancienne dont on m’avait remis les clés à la naissance pour que j’en aie la jouissance.» Les horizons lointains ensuite parcourus ne seront que le prolongement et l’exploration d’une sensibilité rétive à la rentabilité, l’efficacité à outrance, les impératifs de «la machine à réussir et à abrutir». Pour ceux aspirant à «une carrière de rêveur au long cours», il s’agit de faire un pas de côté et de prendre la tangente.
Somnambule dans Istanbul distille ses facéties, ses rêveries, ses drôleries (voir comment l’auteur se rendra compte qu’il a vu la voiture diplomatique d’un dénommé Gorbatchev en 1976 ou 1977 sur un parking de supermarché de la banlieue toulousaine), ses nostalgies, ses joies comme celle de découvrir des lieux le glissant dans la peau d’un voyageur du XIXème siècle «ni enrôlé dans l’industrie du voyage ni lâché dans une ville-musée perpétuellement endimanchée».
Continents perdus
Qu’est-ce que «l’essence du voyage» selon Faye ? «Tenter de saisir en quoi l’on n’est pas originaire d’un lieu mais de plusieurs». Bien sûr, la déception est parfois au rendez-vous, notamment quand «la bêtise globale» décline les mêmes signes, les mêmes enseignes, les mêmes marchandises.
Au fil des pages, on suit les pas de l’écrivain.
Voici Istanbul, les anciennes républiques soviétiques, Ostrava, Prague, la Sibérie, le Groenland, les cinq kilomètres carré de l’île de Sercq, l’archipel d’Okinawa, San Francisco sur les traces des lieux de tournage du Sueurs froides d’Hitchcock… Choses vues, souvenirs et digressions s’invitent au gré d’une quête intime aux accents universels «la notion d’identité avait à voir, chez moi, comme je le soupçonnais, avec celle de continents perdus que l’on s’échine à retrouver et à préserver en soi, par fidélité à une certaine idée de soi-même».
«Les gares sont des stations-services de la mélancolie où les voyageurs en manque viennent refaire le plein», note à un moment l’écrivain. Si des accents désenchantés pointent parfois le bout de leur nez, une capacité d’émerveillement intacte donne sa lumière particulière à ce récit. À l’instar d’un Jean Rolin ou d’un Jean-Paul Kauffmann, Eric Faye est de ces promeneurs solidaires des paysages et des êtres dont ils ont su voir la beauté secrète pour nous l’offrir. On dit merci.
Somnambule dans Istanbul • Stock