Moins connu que ses compatriotes anglais Martin Amis, Jonathan Coe ou Julian Barnes, Michael Bracewell, né en 1958, gagne cependant à être lu. Par exemple avec Un éternel jeune homme, paru en 2008 en France chez Phébus après les remarquables Une époque formidable (2002) et Saint Rachel (2004) édités par Le Dilettante.
On suit sur près de quatre cents pages la destinée de Martin Knight, né en 1960 dans une banlieue pavillonnaire de Londres. Martin est un adolescent rêveur, romantique, baignant dans les mots des poètes et des rêveries artistiques qui lui semblent un bon moyen de gagner le cœur des filles. À dix-huit ans, il décide que son existence s’envisagerait désormais à travers trois valeurs : « l’argent, l’esthétique et l’amour ».
À cet étudiant médiocre, l’époque va donner sa chance et le révéler en le convainquant que « le commerce pouvait être beau ». Analyste-programmeur dans une société d’informatique en pleine expansion au cœur d’une City bouillonnante de capitaux, Martin s’élève rapidement et rencontre la femme idéale en la personne de Marilyn Fuller, jeune fille persuadée que « faire du shopping était un mode de vie » et ayant rarement trompé l’oisiveté dorée que lui permet sa famille bourgeoise d’intellectuels de gauche.

La vie mode d’emploi
À travers Martin et Marilyn, Un éternel jeune homme peint une nouvelle classe narcissique, autosatisfaite, baignant dans un hédonisme consumériste, épousant le goût du luxe et des apparences que les années quatre-vingts lui tendent comme une évidence. « La prospérité ambiante ne laissait apparemment aucune place au doute » et Martin s’engouffre dans ce conformisme sans perdre de vue « le désir de paraître subversif ». À cette date, David Brooks n’avait pas encore inventé le concept de « bobos » pour désigner ces bourgeois-bohèmes, mais Michael Bracewell en avait cerné les archétypes sous les latitudes thatchériennes.
Si Un éternel jeune homme possède une vraie dimension politique et sociologique, celle-ci ne chausse jamais les bottes cloutées du roman à thèse.
C’est en romancier que Bracewell décrit l’ennui des riches et le pouvoir corrupteur de l’argent, à l’image de cette scène où Martin reçoit sa première carte de crédit qu’il tient dans la main « comme un revolver chargé, ou un paquet de cigarettes plein ». À cette carte succèderont plus tard une Gold et le début des problèmes : « il dépensait bien plus qu’il ne gagnait, mais le personnage qu’il incarnait se faisait le complice d’une culture suggérant que c’était parfaitement normal. Le montant réel des sommes en jeu était devenu abstrait. Pour ses prodigalités, Martin se trouvait ainsi des excuses. Les banques l’y encourageaient, et son employeur avait confiance en lui. La gêne et la pauvreté étaient des maux regrettables qui affectaient les membres d’une communauté lointaine, sans véritable consistance. »
De la destruction des villes en temps de paix, défigurées par les parkings, bureaux, supermarchés et autres centres commerciaux, à l’eau grise de la lassitude qui monte sur ce jeune couple, Bracewell brasse la peinture d’une société et celle d’individus avec un regard à la fois sec et mélancolique, aux accents parfois fitzgéraldiens.
Sans surprise, un retour au réel décillera les yeux de notre héros désemparé devant les « boutiques du West End et leurs soldes avant fermeture définitive ; la stupidité des journaux et des publicités ; le spectacle des vitrines blanchies à la chaux de restaurants autrefois en vogue ; l’américanisation des jeunes à tous crins ; l’omniprésence des mendiants à chaque rue ; l’impression d’avoir brûlé les étapes… » Enfin viendront la vie et son mode d’emploi.
Un éternel jeune homme • éditions Phébus
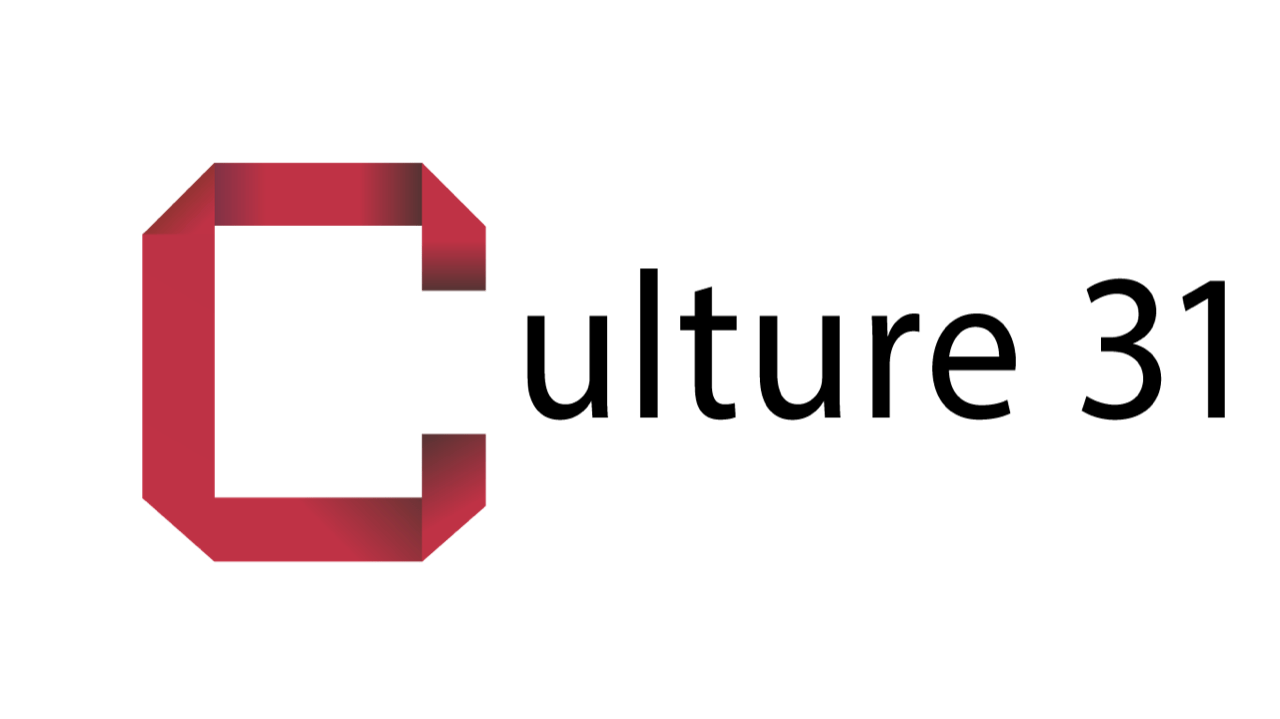


![【 Rencontre • #Culture 】
Aujourd'hui, dans "les acteurs de la culture", nous vous présentons Philippe Cros.
.
Philippe CROS a participé pendant près de 30 ans au rayonnement de la Fondation Bemberg. Ce passionné d’Art et d’Histoire, a plus d’une corde à son arc : auteur, comédien, metteur en scène, dramaturge…
.
Pour la série [Les arroseurs arrosés], il revient sur ses émotions de spectateur, son engouement sans faille pour les propositions de l’Opéra National du Capitole, mais aussi sur la reprise de sa pièce à succès « Meurtre au Chalet », au Grenier Théâtre.
.
« Je me suis rapproché du théâtre grâce aux textes »
.
🔗 Retrouvez son interview sur le site de Culture 31 (lien dans notre bio)
.
.
.
#acteurdelaculture #philippecros #culturetoulouse #toulouse #culture31 @phil.cros @fondation_bemberg @operanationalducapitole @greniertheatre](https://scontent-waw2-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/488887512_1748020536070934_4585849401610743682_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=88F6eVdUgNEQ7kNvwEPkHND&_nc_oc=AdnGZAPEHzV2fomQ9xBJ6lwf9cTID5XWMdSIJeyf3tQnvl7zyIrq73Cefzj6wPsgZ-4&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-waw2-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=lfxdX60al5iglictGh_VKA&oh=00_AfGwsrAFwEzpoxpauaaF8g5QmTbO-Oc0v25CGaK9h0hU6A&oe=67F83224)

















