Dans La dolce vita (Palme d’or 1960), le cinéaste italien dirige pour la première fois Marcello Mastroianni qui deviendra dès lors en quelque sorte son double cinématographie et que l’on retrouvera dans Huit et demi, La Cité des femmes, Ginger et Fred et Intervista.
Avant cela, il y eut cette longue chronique (près de trois heures), ironique et sombre, d’une certaine haute société romaine à la fin des années 1950. La Seconde Guerre semble très loin, la reconstruction a fait son œuvre, la croissance économique est au rendez-vous, les mœurs changent. Construit autour de séquences apparemment disparates, mais savamment agencées, La dolce vita nous entraîne dans le sillage de Marcello Rubini, journaliste de presse people, au cœur d’une vie mondaine.

Il y a des ivresses et des gueules de bois, des nuits agitées et des petits matins blêmes, des boîtes de nuits, bourgeoises désœuvrées, des riches désespérés, des suicides, des actrices célèbres, des faux miracles, des fêtes dans des châteaux. L’ennui et la vacuité ne sont pas absents de ces existences en quête de sens. Le sacré a laissé place au kitsch.
Modernité et désenchantement
Dans un noir et blanc somptueux, Fellini filme une Rome inoubliable : de la mythique scène de la fontaine de Trevi avec Anita Ekberg à la via Veneto reconstituée en studio. Quittant la narration linéaire et l’inspiration néoréaliste de ses débuts, le réalisateur pose les jalons d’un univers plus personnel qui donnera naissance à l’adjectif « fellinien ».
Œuvre de la modernité et du désenchantement, La dolce vita ne possède pas l’inventivité visuelle de Huit et demi ni le burlesque mêlé de nostalgie d’Amarcord, mais diffuse sa beauté, son élégante mélancolie au fil d’images magnétiques. Paolo Sorrentino saura s’en souvenir avec l’éblouissant La grande bellezza (2013), autre déambulation romaine sur les pas d’un journaliste mondain désabusé.
LES FILMS QU’IL FAUT AVOIR VUS

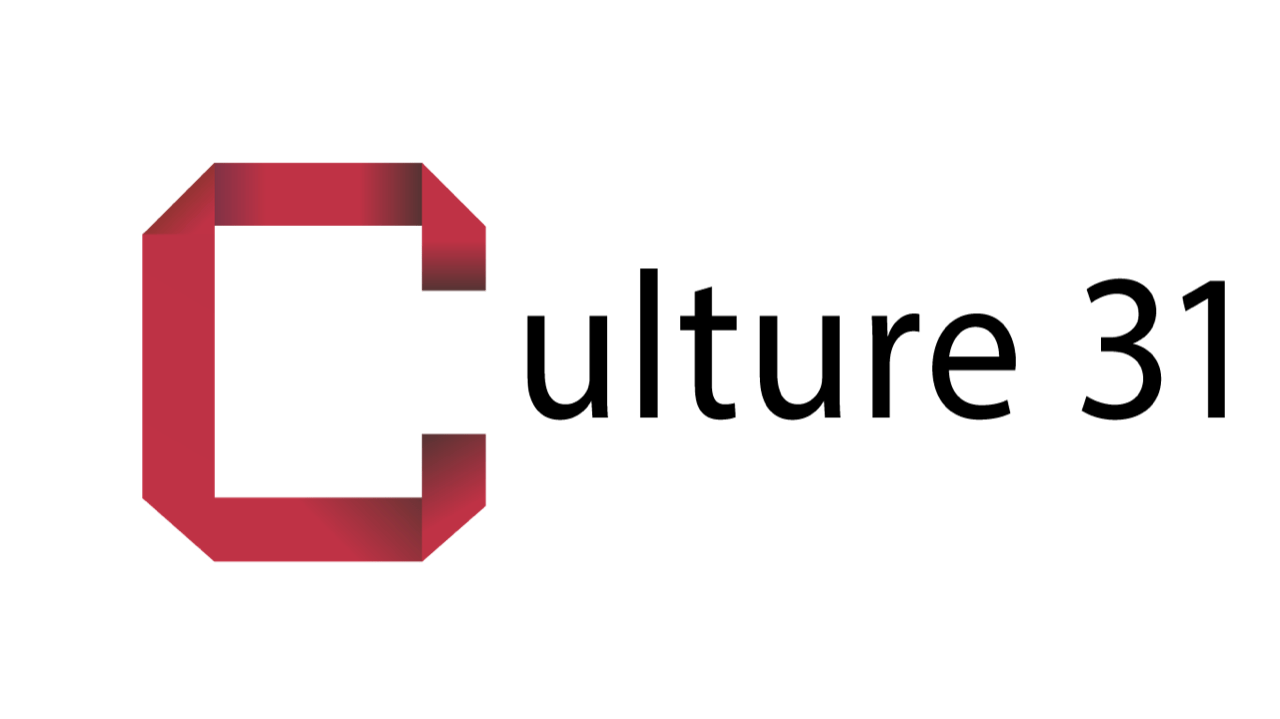






![【 Rencontre • #Culture 】
Aujourd’hui, dans « les acteurs de la culture », nous vous présentons l’artiste Dominique Kermène.
.
Formée aux Beaux-Arts, cette peintre et graveuse francilienne délivre jusqu’au 31 mai 2025 un art brut et libre, inspiré par la nature et l’humain, à la Galerie 21. En somme, il s’agit d’une quête trouvée de liberté intérieure, qu’elle dévoile ici comme une visite.
.
« [Le] travail d’artisan d’art me plaît […] Cette exposition, c’est une vie d’artiste et ce n’est pas fini » .
.
🔗 Retrouvez son interview sur le site de Culture 31 (lien dans notre bio)
.
.
.
#acteurdelaculture #musiqueclassique #galerie21 #dominiquekerme #culturetoulouse #toulouse #culture31 @galerie21toulouse @dominiquekermene](https://scontent-lhr6-2.cdninstagram.com/v/t51.75761-15/489811343_18280379245251283_198464044381026463_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=HUhKQrGb930Q7kNvwFFMW7v&_nc_oc=Adn9_H9p9sJJ-fTyKHxsiC_hZDg-wAqZnynTYSNDGOTG4QevUBMfeKJY6ke4Mm6bEq0&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr6-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=1Y4nZ55_Xlwr_CP1bMwZ0g&oh=00_AfFd7Q2JxmYtbjfwnk4XD93i4ZIbrXd0qKFEabHirf0Qtg&oe=68017845)












