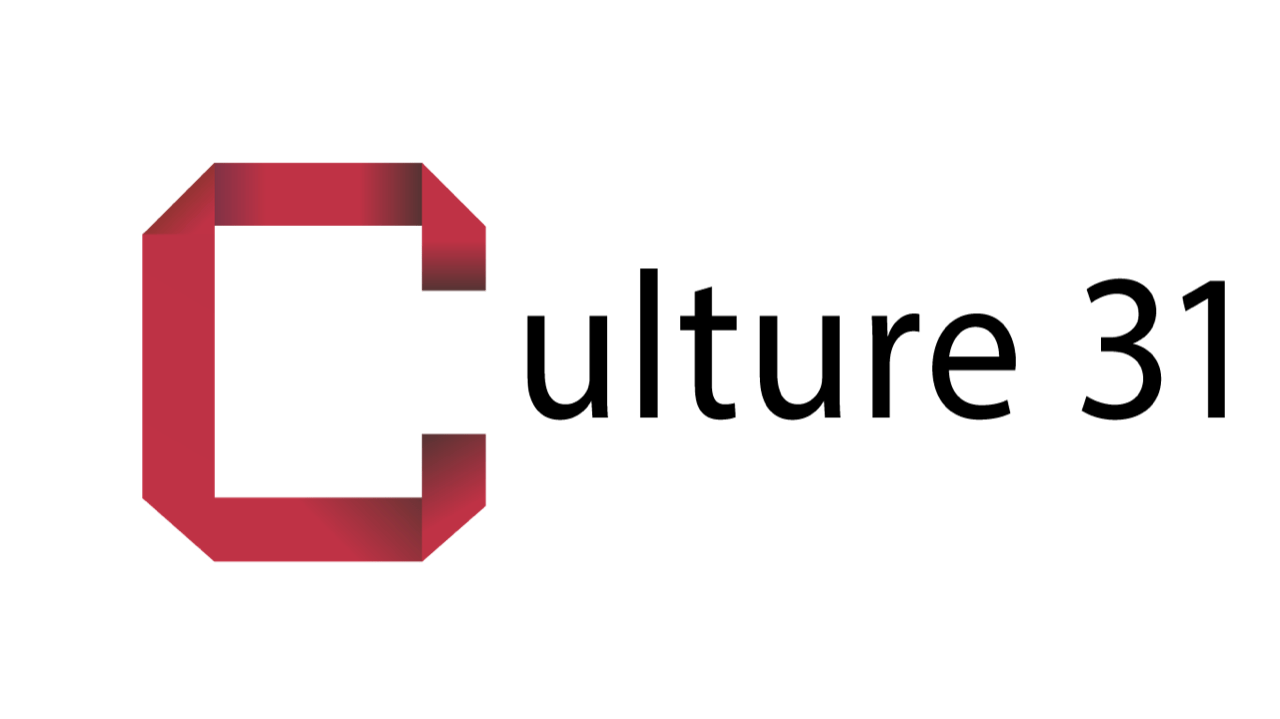Reservoir Dogs de Quentin Tarantino
Reservoir Dogs n’est sans doute pas le meilleur film de Quentin Tarantino (on peut lui préférer la mélancolie et la nostalgie de Jackie Brown ou de Once Upon a Time… in Hollywood), mais l’on a rarement assisté à une telle entrée dans la carrière, pleine de maestria, que la plupart des films suivants confirmeront. Ceux qui le virent lors de sa sortie, en 1992, comprirent aussitôt qu’il faudrait compter avec ce cinéaste de moins de trente ans. Le générique – avec l’apparition au ralenti de huit hommes dont six en costumes noirs, chemises blanches et lunettes noires sur la musique de Little Green Bag de George Baker Selection – et la scène d’ouverture – longs dialogues dans une cafétéria sur le sens des paroles de Like a Virgin de Madonna et la nécessité de laisser un pourboire – donnent le ton. Ce qui s’annonce comme un polar va se nourrir de culture populaire et de références multiples tout en suscitant une jubilation immédiate.

Autre caractéristique de ce qui deviendra la « patte » Tarantino : l’art du casting. Ici, une vedette incarnant notamment le « Nouvel Hollywood » (Harvey Keitel) côtoie des talents en devenir (Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen) ou des apparitions pour happy few (l’écrivain Eddie Bunker, Tarantino lui-même). De même, l’utilisation de la musique, la narration non-linéaire et les flash-backs ou le mélange d’humour et d’ultra violence seront des marqueurs du style du cinéaste.
Miracle de la fiction
Reservoir Dogs est un énième film de braquage, mais l’on ne verra jamais celui-ci. Le cinéaste filme l’avant et l’après, les préparatifs de l’équipe et les retrouvailles des survivants dans un entrepôt après le fiasco de l’opération, vraisemblablement causé par la présence d’un policier infiltré au sein du gang. Tarantino s’offre des digressions, multiplie les clins d’œil cinéphiliques (de Jean-Pierre Melville à John Woo), mais ne perd jamais de vue l’efficacité diabolique du scénario qu’il a écrit. Le plaisir de raconter une histoire et de la filmer jaillit à chaque plan. Les acteurs livrent, chacun à leur manière, des compositions époustouflantes.

Les personnages que met en scène Tarantino sont les purs produits d’une post-modernité déshumanisante. Ils n’ont pas d’identité (les gangsters sont affublés de pseudos : Mister White, Mister Blonde, Mister Orange, etc.), parlent avec des mots qui ne leur appartiennent pas, empruntent des codes et des clichés (à l’image de leur tenue ou de leurs références « culturelles »). La bêtise et la sauvagerie le disputent dans ce film noir sanglant à la loyauté et à l’honneur. Tarantino posait un regard sans illusions sur la condition humaine. Plus tard, il le nuancerait en réinventant la Seconde Guerre mondiale ou en sauvant Sharon Tate de ses bourreaux. Miracle de la fiction.