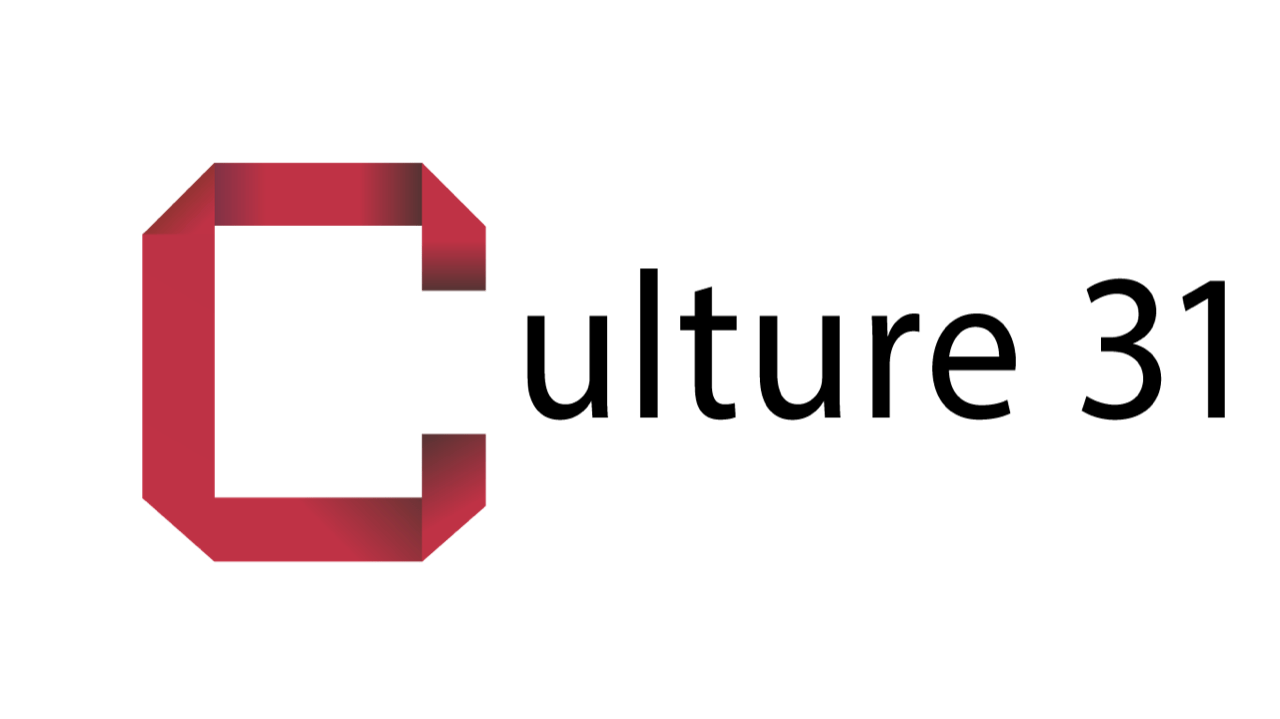Premier des trois films que Jean-Pierre Melville et Alain Delon tourneront ensemble, Le Samouraï, sorti en 1967, constitue l’un des sommets de leurs carrières respectives. Le style melvillien est ici à sa quintessence – épure, minimalisme, tentation de l’abstraction – et influencera à des titres divers des cinéastes tels que Michael Mann, John Woo, Quentin Tarantino ou Jim Jarmusch. Peu de dialogues, pas de psychologie : le film est essentiellement descriptif et se focalise sur les gestes ou les actions des personnages au premier rang desquels Jef Costello, tueur à gages quasi mutique rendu inoubliable par l’interprétation minérale de Delon. Un chapeau et un imperméable constituent « l’uniforme » de ce samouraï moderne dont la singularité paradoxale consiste à se fondre dans un monde où les hommes se ressemblent et paraissent interchangeables.

Le vol d’une voiture, un meurtre, des interrogatoires, des filatures, la mise sur écoutes d’un appartement comptent parmi les étapes du cheminement du héros vers sa rencontre programmée avec la mort. Celle-ci est personnifiée par une pianiste de jazz noire (Cathy Rosier) qui disculpe Costello devant les policiers avant de devenir sa cible.
Dernier grand fauve
Ce film noir, construit en boucles et en scènes qui se répondent, s’ouvre avec une fausse citation du bushido (le code d’honneur des samouraïs) créée par Melville (« Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï. Si ce n’est celle du tigre dans la jungle. Peut-être… ») et s’achève par une sorte de seppuku revisité. Pourquoi plus de cinquante ans après Le Samouraï conserve toute sa beauté et sa puissance magnétiques ? Par la présence devenue iconique de Delon et par la mise en scène de Melville, chef-d’œuvre de stylisation sans esbroufe dont la photographie (alternant les gris, les verts, les noirs) épouse à la perfection la solitude crépusculaire du personnage.

Fable sur la réclusion, incarnée notamment par l’oiseau en cage dans l’appartement ascétique de Costello, le film anticipe comme d’autres grandes œuvres de son époque l’avènement d’une société de surveillance et d’une pieuvre technologique qui n’en étaient alors qu’à leurs prémices. Poursuivi par des policiers (menés par un François Périer à la fois cynique et humain) et les membres d’une organisation criminelle évoquant une banale entreprise, Jef Costello apparaît comme l’un des derniers grands fauves en liberté avant la domestication générale. L’une de ses phrases – « Je ne perds jamais, jamais vraiment. » – prend des airs de défi métaphysique et de baroud d’honneur face à une défaite annoncée.