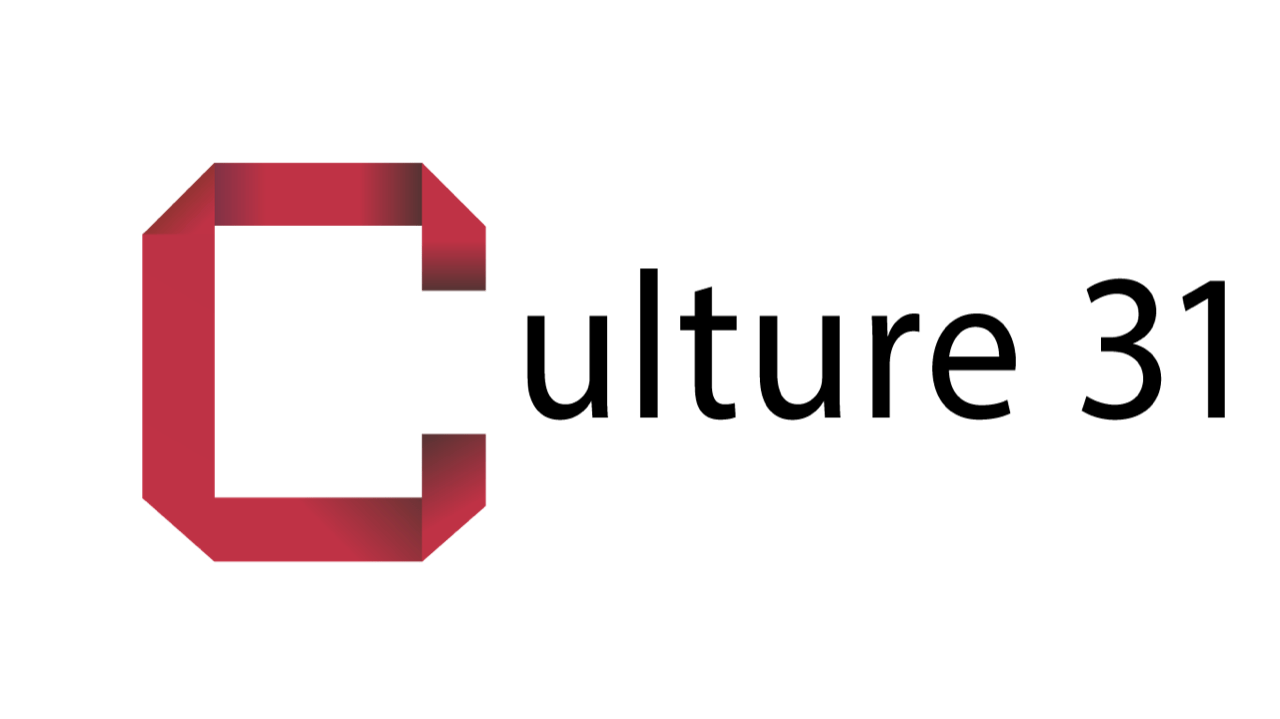Lorsqu’il présente The Tree of Life au festival de Cannes en 2011, où il obtiendra la Palme d’or, Terrence Malick n’était plus vraiment le mystérieux cinéaste qui disparut des écrans – au sens propre et figuré – durant près de vingt ans après son deuxième long-métrage, Les Moissons du ciel, en 1978. Entre ce film et La Ligne rouge en 1998 qui marqua son retour, suivi en 2006 par Le Nouveau Monde, pas d’interviews ou presque, quasiment pas de photographies de lui. Sa biographie collectionnait les points d’interrogation. On sait qu’il vécut durant cette période à Paris, un moment à Toulouse selon certaines sources. Au final peu importe tant son cinquième film s’imposa avec une puissance rare.

L’histoire de The Tree of Life ? L’origine du monde et la vie d’une famille américaine dans une petite ville du Texas dans les années 1950. Du Très-Haut au très bas, Terrence Malick filme les éléments, la foi, l’espérance, le doute, le mystère… Le risque était de tomber dans la désincarnation et l’esthétisme, mais le cinéaste sait nous ramener sur terre notamment à travers la chronique familiale mettant en scène trois jeunes garçons et leurs parents. La mère (Jessica Chastain), figure mariale, n’est que bonté et charité, le père force et autorité. Brad Pitt campe magistralement cet homme dur, autoritaire et pourtant aimant, obnubilé par la réussite, artiste raté devenu un mâle dominant darwinien. Face à lui se dresse Jack, le fils aîné révolté, avant qu’un deuil ne touche la famille.
Comme une prière dans une langue oubliée
Des voix off s’adressent tantôt aux vivants, aux morts, à Dieu. Trente ans plus tard, Jack (Sean Penn) n’a rien oublié. Il allume une bougie, mais vit dans une ville de verre où le sacré et la nature ont été chassés. Il attend la communion des saints. La caméra fait corps avec les acteurs, les décors, les ciels, les arbres. La grâce et la poésie éclaboussent l’écran.

Des plans ressemblent à des tableaux. Des images jamais vues auparavant se succèdent. D’un banal robinet au visage d’un bébé, d’une sauterelle à un volcan en éruption, d’une cellule à la planète : tout prend place dans ce kaléidoscope élégiaque et cette symphonie visuelle. Le cinéaste bouscule la chronologie. Il faut s’appeler Terrence Malick pour renouer avec un cinéma qui, de Murnau à Tarkovski, sonde les âmes, l’invisible et nos présences charnelles. The Tree of Life est beau à en pleurer, comme une prière dans une langue oubliée.