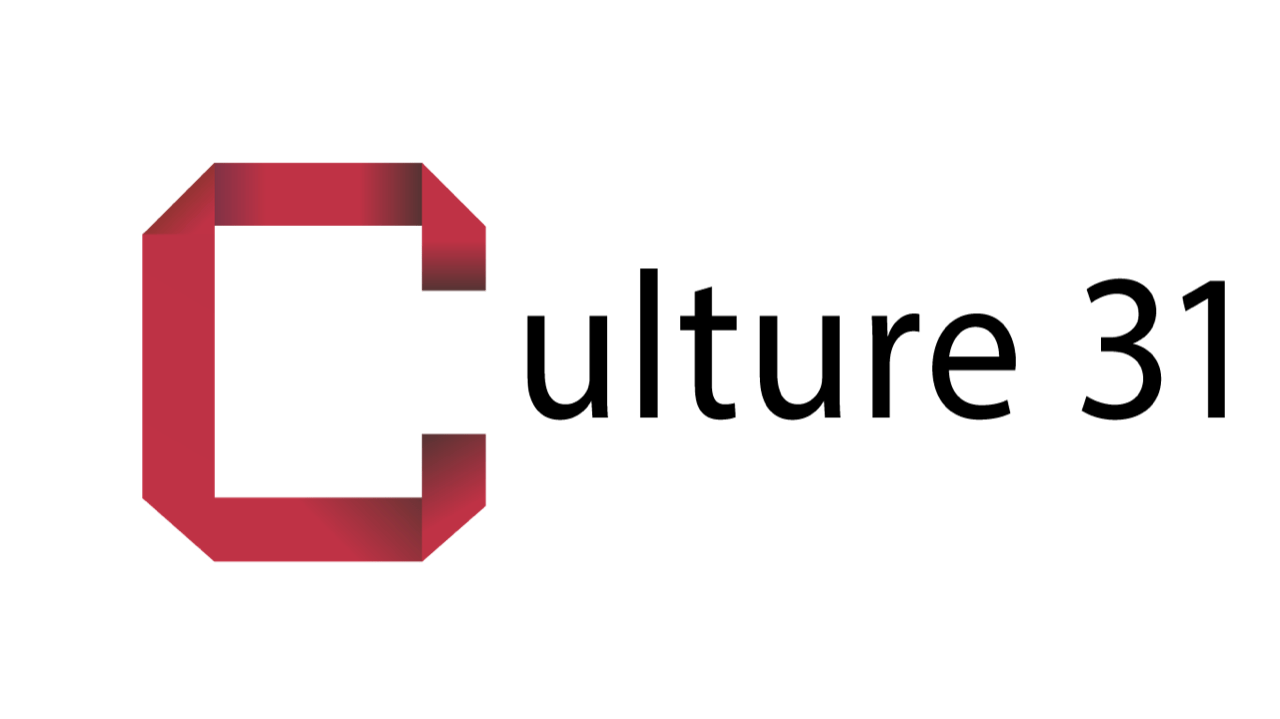Le dernier roman en date – Prix Pulitzer de la fiction 2007 – de l’auteur de tant d’œuvres marquantes (Méridien de sang, De si jolis chevaux, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme) retrace la vie d’un homme et de son fils au cœur d’un monde postapocalyptique. Dans un coin de ce qui était les Etats-Unis, après ce qui a dû être une guerre nucléaire, ces deux survivants charrient avec eux un Caddie de supermarché, vestige du monde d’avant, de l’abondance et de la surconsommation, qui transporte leurs maigres bagages : un peu de nourriture, des couvertures de fortune, de quoi confectionner des bâches contre la pluie, la neige et le froid. Surtout, ils portent le feu, sans lequel ils seraient condamnés.
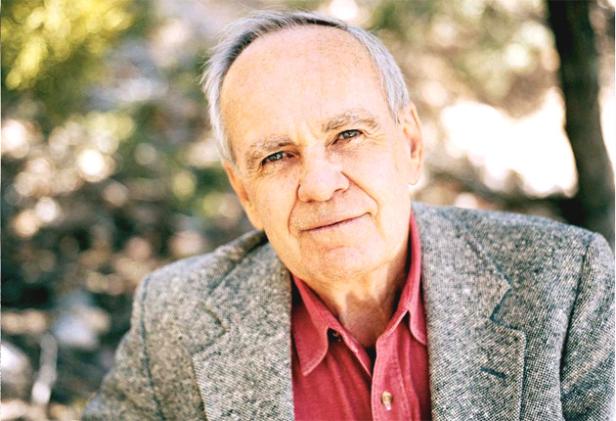
Autour d’eux, ce n’est qu’un paysage de désolation couvert de cendres et de poussière où l’on aperçoit des troncs d’arbre carbonisés, des maisons incendiées ou des magasins pillés depuis des années. De crépuscules en aubes grises, le soleil est constamment voilé. Ne subsiste que du noir, du blanc ou du gris comme cette « neige sale » que l’on mange quand il n’y a plus rien. Sur la route, l’homme et l’enfant croisent des restes de corps suppliciés ou saisis dans leur voiture par la grande catastrophe. Puis, il y a ces silhouettes inquiétantes, portant des masques et des combinaisons de protection biologique, qui traînent derrière elles de maigres esclaves.
La lumière qu’ils portaient en eux
La Route entraîne sur près de deux cent cinquante pages le lecteur aux côtés de ses personnages. Avec eux, on marche vers le sud et l’océan, on a faim, on a froid, on craint de voir surgir les barbares, on découvre des boîtes de conserve et une réserve d’eau comme la promesse de vivre quelques jours de plus. Cormac McCarthy signe un roman captivant qui ne se nourrit que de sa propre action, fuyant la psychologie ou la reconstitution de ce qui a été et qui n’est plus. Dans ce nouveau monde, la mémoire et les souvenirs ne sont d’aucun secours. À quoi bon laisser des « messages sans espoir à des êtres chers perdus et morts » quand il ne reste que du « temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer » ?
Pourtant, la vie continue, fragile et misérable, sur les pas de l’odyssée aux accents bibliques du père et du fils. La Route se lit comme une prière sèche mais terriblement incarnée dont la poésie surgit avec une force rare : « Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt emportées çà et là dans le vide sur les vents froids et profanes. Emportées au loin et dispersées et emportées encore plus loin. Toute chose coupée de son fondement. Sans support dans l’air chargé de cendre. Soutenue par un souffle, tremblante et brève. Si seulement mon cœur était de pierre. » Dans ces ténèbres et sous ces cendres, il faudra protéger le feu encore, ne jamais renoncer et perpétuer cette vie qui « ne se mesurait qu’à la lumière qu’ils portaient avec eux ». On n’oublie pas de sitôt les dernières pages déchirantes de beauté, de tristesse et d’espérance de ce grand livre.
La Route • Editions de l’Olivier